Ceci est une note de lecture et une chaude recommandation de lire cet ouvrage collectif : Le syndicalisme est politique (La Dispute, 2023, 204 p., 16 €), dirigé par Karel Yon, sociologue à l’IDHES (CNRS, Université Paris-Nanterre) et Sophie Béroud, professeure de science politique à l’Université Lumière Lyon 2, membre du laboratoire Triangle.
Le syndicalisme peut-il changer le monde ? Ou doit-il se contenter de lutter dans les entreprises ? C’est toute la question qui se trouve au cœur du travail fourni.
Qu’est-ce donc, ce processus de dépolitisation du syndicalisme ?
La dépolitisation met une distance avec l’action politique elle-même, mais aussi une certaine méfiance, voire une défiance, vis-à-vis de l’idée que le syndicalisme devrait avoir un projet de société.
La dépolitisation s’inscrit dans les évolutions du syndicalisme depuis plusieurs décennies, caractérisées par une « autonomisation du champ syndical » : le syndicalisme se déploie de plus en plus dans un univers autoréférencé, sans être articulé aux luttes menées sur d’autres terrains sociaux.
Jusqu’aux années 1970, il allait de soi que syndicats, partis de gauche et autres associations partageaient un horizon de dépassement du capitalisme. Le syndicalisme était une composante d’un mouvement social plus large, le mouvement ouvrier.
Depuis les années 1980, en raison d’évolutions institutionnelles et idéologiques, le syndicalisme s’en tient pour l’essentiel au jeu des relations professionnelles ou à ce qu’on pourrait appeler la « démocratie sociale ».
Cependant les acteurs syndicaux commencent à mesurer les limites de cette inclination à l’action auto-centrée sur l’entreprise et la négociation collective, face au raidissement autoritaire du néolibéralisme, à la crise écologique ou à l’importance des luttes fondées sur les rapports sociaux de genre ou de race.
Les racines de ce processus qui conduit à la dépolitisation de l’action syndicale ?
La volonté, à partir des années 1980, est affichée de prendre de la distance par rapport aux partis politiques. La première organisation à le faire, c’est la CFDT, avec une politique dite de « recentrage », par laquelle les militants entendaient se recentrer sur les activités dans l’entreprise, sur le syndicalisme dans l’entreprise.
Pour la CGT, cela se joue dans la première moitié des années 1990, après la chute du mur de Berlin.
Mais il y a d’autres facteurs, et surtout un processus de professionnalisation des représentants syndicaux, qui est liée au développement des instances de représentation du personnel dans les entreprises à partir des lois Auroux (1982).
Renforcement du droit d’expertise, mise en place des comités d’entreprise, des CHSCT : tout cela conduit, jusqu’à aujourd’hui, à une professionnalisation et une technicisation de la façon d’intervenir dans les espaces de représentation et de négociation, qui contribuent elles aussi à cette autonomisation de l’activité syndicale.
Ces deux phénomènes – mise à distance des partis et professionnalisation du syndicalisme – participent à la dépolitisation de l’action syndicale et se nourrissent l’un l’autre.
Pourtant la fameuse Charte d’Amiens ? Elle proclame que « le syndicalisme prépare l’émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l’expropriation capitaliste » …
La dépolitisation du syndicalisme est le fait d’avoir abandonné la « seconde besogne », l’horizon de changement du monde. La Charte d’Amiens de 1906 n’est pas seulement une réponse à la construction de la SFIO, sur la façon dont le syndicalisme définit son espace militant hors des partis.
Elle est aussi une réponse à l’État républicain qui, en 1884, adopte une loi qui légalise le syndicalisme mais qui, précisément, a pour objectif de réduire le périmètre de l’activité syndicale à la seule défense des intérêts professionnels.
Dès l’origine, la définition du syndicalisme est un enjeu de lutte, pas seulement de définitions politiques ou idéologiques, mais aussi un enjeu institutionnel
La CGT de la Charte d’Amiens, la CGT de la « double besogne », c’est aussi une forme d’organisation qui est à la fois professionnelle et territoriale, précisément parce qu’il y a l’idée que l’action syndicale, ce n’est pas simplement défendre les travailleurs face à leurs patrons, c’est aussi organiser la classe ouvrière en la dotant d’institutions spécifiques pour préparer l’avènement d’une autre société.
Les transformations institutionnelles depuis les années 1980, qui se sont accélérées depuis une dizaine d’années, vont à l’encontre de ce modèle organisationnel en cherchant à confiner l’action syndicale au seul terrain de l’entreprise.
Et le « dialogue social », qu’en reste-t-il face au tournant autoritaire du néolibéralisme ?
Dans les années 1990 et 2000, il y avait encore une volonté d’associer les ainsi-nommés « partenaires sociaux » à la production de la norme sociale. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, l’idée d’associer les « partenaires sociaux » est excommuniée, le prouvent la loi El Khomry, les ordonnances Macron, les deux « réformes » des retraites.
La fusion des instances dans le CSE se traduit sur le terrain par une profonde transformation de ce qu’étaient auparavant les comités d’entreprises, avec des CSE qui deviennent davantage contrôlés par les directions d’entreprises, que ce soit sur l’ordre du jour ou leur déroulement.
Les CSE sont plutôt des chambres d’enregistrement des décisions de la direction. Ce qui conduit les équipes syndicales à se demander ce qu’elles y font.
La CFDT continue d’accorder beaucoup de crédit à cette pratique du dialogue social.
Le sens même donné à l’idée de dialogue social s’est transformé. Il y avait une logique de donnant-donnant, de compromis, qui donnait sa légitimité au syndicalisme réformiste.
Aujourd’hui, le dialogue social sert surtout à disqualifier les organisations syndicales qui tenteraient de créer un rapport de force pour faire valoir leurs intérêts.
Le dialogue social est opposé à la grève, par un État qui n’est qu’un garant des politiques dites pro-business. Il prend de fait le parti des employeurs contre les travailleurs. Les salaires sont perçus en termes de coût du travail, les normes comme des contraintes qui étouffent l’innovation, et les syndicats sont vus comme des obstacles.
Cette expérience du néolibéralisme autoritaire et des transformations de l’État met en crise le syndicalisme de dialogue social.
Le livre aborde le mouvement des gilets jaunes et la façon dont il devrait questionner les syndicats, notamment sur leur « ancrage dans les sociabilités populaires » …
Les gilets jaunes, c’est une partie du monde du travail populaire avec deux grandes composantes. D’un côté, on trouvait une partie pas du tout organisée, très loin des syndicats – notamment parce qu’elle travaille dans de très petites entreprises.
De l’autre, on avait une partie de « déçus » du syndicalisme, des personnes qui avaient pu être syndiquées ou avoir travaillé dans une entreprise avec présence syndicale, mais qui n’avaient plus confiance, qui ne croyaient même plus à la possibilité que l’action dans l’entreprise puisse aboutir à quelque chose.
Cela renvoie à la perception des syndicats comme relevant d’activités très spécialisées, vus par les salariés des classes populaires comme des institutions qui leur sont extérieures.
D’où la nécessité de rompre avec cette vision du syndicalisme comme une institution extérieure, et l’ancrer dans des pratiques quotidiennes et partagées.
Ce sont des éléments qui ont existé dans l’histoire du syndicalisme, avec les unions locales, les bourses du travail, des réseaux de coopératives, d’associations sportives de vélo ou de foot … Il s’agit de réinsérer les syndicats dans un ensemble de pratiques populaires, et penser des espaces où l’activité syndicale pourrait être en lien avec d’autres types d’activités, culturelles, festives.
Sur les ronds-points, beaucoup de choses étaient partagées, les moments de discussions politiques ou sur le travail n’étaient pas séparés d’autres moments, ils étaient insérés dans d’autres pratiques de sociabilité : on faisait la cuisine, on montait la cabane.
Pour un certain nombre de travailleurs, comme dans l’aide à domicile ou l’hôtellerie-restauration, qui concernent beaucoup de femmes, ce n’est pas toujours facile de trouver sa place dans le syndicalisme. Réfléchir à la diversité des types d’activité sociale, c’est aussi une façon de s’adresser plus largement à ses salariés des classes populaires. On a pu l’observer, par exemple, dans le renouveau du syndicalisme américain, avec des centres de travailleurs où il y a de l’aide pour les papiers, pour l’alphabétisation, mais qui sont aussi des lieux festifs, où l’on se retrouve pour manger, etc.
Le mouvement contre la réforme des retraites, qu’a-t-il posé comme problèmes ?
Autant le mouvement a été célébré par sa capacité à mobiliser des salariés dans toute la France, dans des univers sociaux très différents, depuis les grandes métropoles jusqu’aux petites villes rurales, autant il a révélé les difficultés des militants à organiser des assemblées générales sur les lieux de travail et à inscrire les grèves dans la durée.
C’est le signe d’une fragilisation préoccupante. Comme les forces militantes sont moins nombreuses, les unions locales sont les premières à en faire les frais. Le rôle de ce syndicalisme territorial est d’autant plus compliqué qu’il ne peut pas s’appuyer sur des moyens spécifiques, contrairement au syndicalisme d’entreprise. C’est un enjeu organisationnel important.
Karel Yon avance la piste d’un front syndical, qui serait une composante de la coalition : « la politique est une chose trop sérieuse pour la laisser aux partis » … « Dans une coalition de gauche élargie, le pôle syndical a toute légitimité à être directement représenté pour porter la voix du monde du travail »
L’idée centrale de l’auteur est de partir du constat que le système politique est tendanciellement excluant pour les classes populaires, et que dans une coalition de gauche élargie, le pôle syndical a toute légitimité à être directement représenté, précisément pour porter cette voix du monde du travail.
L’époque est révolue des relations de subordination entre tel syndicat et tel parti, et les logiques de débauchages individuels ont leurs limites. Pour autant, le mouvement syndical doit être un acteur en tant que tel de l’élaboration de politiques alternatives.
La menace de l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite est une forme d’alerte sur une situation exceptionnelle, qui pourrait justifier que le mouvement syndical en vienne à recourir à des moyens exceptionnels, en se reposant sérieusement la question de son action politique.
JG, mars 2024.
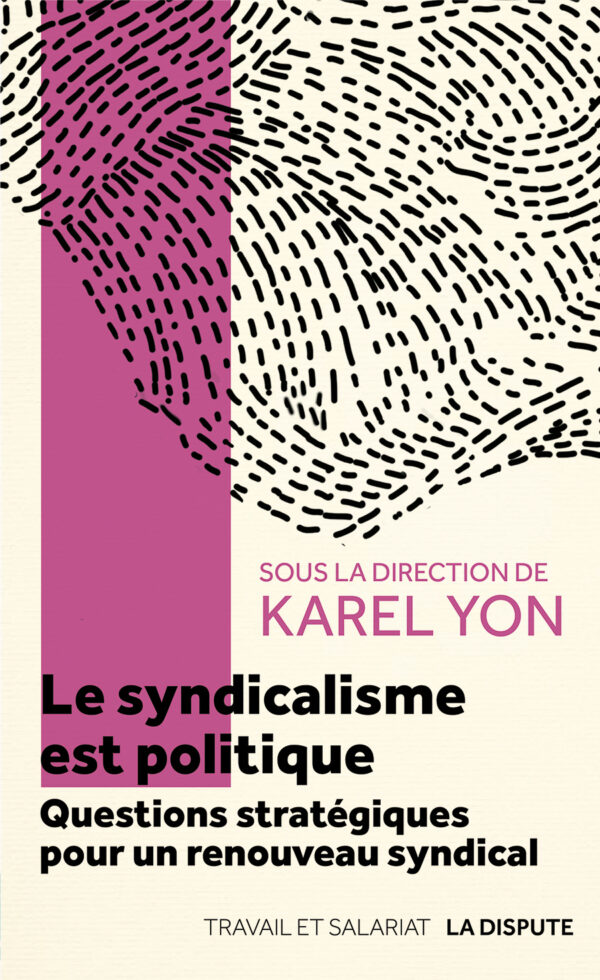
Merci à Jean G. de nourrir le débat sur l’état des lieux syndical et les stratégies de son renouveau.
Aplutsoc mène des discussions suivies, sur l’objet et les moyens de l’intervention dans les syndicats de ceux qui ont la conviction que la défense des intérêts des travailleurs ne peut s’accommoder de la domination du capital. A toutes fins utiles la date d’une prochaine discussion en visioconférence sur ce thème a été prévue le 28 mars.
Le travail dirigé par K. Yon, si l’on en croit l’intéressante recension qui en est fait, se focalise sur les structures en soulignant les limites du syndicalisme tel qu’il est pratiqué dans les entreprises et les exigences patronales de professionnalisation du syndicalisme et de son intégration. A l’inverse les auteurs appellent de leurs vœux une pratique syndicale qui ferait réapparaître, à partir du lieu de vie, de l’interprofessionnel, des bourses du travail, des activités sociales ouvertes largement aux précaires et aux salariés les plus exploités, les plus isolés, les plus éloignés du syndicat. L’exemple du renouveau syndical américain mêlant alphabétisation, lutte pour les papiers et ambiance festive est donné.
Si l’on reprend cet exemple du renouveau syndical américain il apparait cependant qu’une des raisons majeures du mouvement vers la syndicalisation s’est produit en relation avec les grandes victoires salariales des travailleurs de l’automobile qui à partir de la grève dans les big three (Stellantis, Ford, General Motors) ont servi de catalyseur dans bon nombre des entreprises sous-traitantes qui ont remplacé les grandes concentrations de salariés dans cette industrie. Sans parler de l’objectif explicite de s’attaquer aux entreprises non syndiquées comme Toyota et Tesla.
Mais ce n’est pas tout, la perspective ouverte par les grévistes de l’UAW est explicitement politique. Il s’agit d’un appel à la grève générale. Dans le contexte Etazunien où la chose est illégale on aurait tort de dauber sur le fait qu’un appel à la grève générale le 1er mai 2029 est une perspective lointaine. Il s’agit en fait de la date à laquelle les accords sur les salaires et les statuts devront être renégociés et pas seulement dans l’automobile puisque l’UAW appelle les syndicats des autres branches à fixer la même échéance à leurs accords et autres dispositifs contractuels.
Ce n’est pas seulement son caractère illégal qui fait de la grève générale aux USA une perspective politique, c’est son caractère de mouvement de masse appelant tous les secteurs du salariat à se dresser contre leurs exploiteurs. La charte d’Amiens souvent citée de travers et pour de mauvaises raisons (la prétendue « indépendance réciproque des partis et des syndicats » chère aux lambertistes) ne conjugue pas seulement la double besogne, celle de combattre pour les revendications immédiates et celle d’en finir avec le système politique du capital, elle en indique aussi le moyen. Pour la charte d’Amiens ce moyen politique s’appelle aussi grève générale.
Et si l’UAW met aujourd’hui en avant cette perspective politique pour tous les travailleurs américains c’est le résultat de luttes politiques dans le syndicat de l’automobile où des bureaucrates compromis et corrompus qui dirigeaient depuis des lustres ont été déboulonnés (*).
On ne peut s’interroger sur les 40 années de reculs sociaux que les travailleurs français ont vécu et, dernièrement, sur l’incapacité d’une des plus importantes mobilisations à faire céder le gouvernement sur sa « réforme » des retraites, sans constater le refus des directions syndicales d’avancer toute perspective de grève générale, toute marche, et même tout pas en avant des millions de salariés qui refusaient le recul de l’âge de la retraite, vers les lieux de pouvoir où se décidait leur malheur. Cette intersyndicale-là, compatible avec le macronisme, attachée à sa manière aux institutions de la république, la cinquième, fait bien sûr de la politique. La stratégie du dialogue social, des sommets sociaux, des Ségur de la santé et autres opérations de déminage avec ses corollaires de journées d’action, de temps forts et autres soupapes, montre bien que les directions syndicales font de la politique. Et laquelle.
Que les syndiqués français ressuscitent dans leurs organisations l’esprit de la Charte d’Amiens cela peut passer par la floraison des grèves de boîte et/ou par le renouveau d’une vie syndicale locale et pourquoi pas culturelle et festive . Mais cela ne se pourra sans combat politique contre les directions et les appareils qui craignent que l’irruption massive des travailleurs ne renverse un pouvoir qui, chaque jour, intègre un peu plus à son fonctionnement ceux qu’il se plait à nommer « ses corps intermédiaires ». Ce combat politique ne pourra se mener efficacement sans la coordination de ceux qui à la CGT, à SUD, à FO, à la FSU veulent en finir avec les divisions et se dresser contre Macron, seule stratégie capable défaire l’extrême droite.
(*) Un « caucus » réformateur, l’UAWD, Unite All Workers for Democracy, a imposé l’élection directe de plusieurs dirigeants de ce syndicat clef du mouvement ouvrier américain, totalement bureaucratisé et ankylosé depuis des années, aboutissant à promouvoir un nouveau dirigeant, Shawn Fain, qui a proposé l’organisation d’une grève ciblée touchant les points clefs de production des trois majors de l’automobile. Cette grève retentissante a été un vrai succès revendicatif (hausses de salaires de 25 % voire plus en 4 ans, fort recul des statuts les plus précaires) et une victoire morale de tout premier ordre.
https://aplutsoc.org/2023/11/26/une-debat-pour-aller-vers-une-greve-generale-dans-le-mouvement-ouvrier-americain/
J’aimeJ’aime